Le découplage moral de l’économie trumpiste
La nouvelle ère Trump 2.0 redéfinit radicalement le paradigme économique mondial, enterrant définitivement le modèle néolibéral qui a dominé ces dernières décennies. Loin d’être une simple continuité de son premier mandat, l’administration américaine actuelle, soutenue par un pouvoir institutionnel sans précédent (judiciaire, législatif et exécutif) et légitimée par sa victoire au vote populaire, déploie un néo-mercantilisme agressif qui menace de reconfigurer complètement les relations économiques internationales. Les analystes qui espéraient une modération institutionnelle de ses propositions les plus rupturistes font maintenant face à une réalité bien plus crue.
Néanmoins, l’intention de cet article est de confronter cette proposition et cette analyse avec le cadre théorique de l’Économie Sociale et Solidaire. L’ESS n’est pas seulement une autre «façon de faire des affaires», mais aussi une proposition d’analyse de la réalité économique qui s’éloigne de l’orthodoxie pour rejoindre d’autres écoles économiques hétérodoxes telles que l’économie féministe ou même la théorie monétaire moderne. L’ESS s’est nourrie de la proposition d’un économiste moral reconnu, Karl Polanyi, qui a acquis une renommée renouvelée à la suite de la crise financière de 2008, lorsque de nombreux rédacteurs ont évoqué ses travaux pour expliquer les causes de cette crise. Au risque d’une simplification excessive, on identifiait le «découplage» de l’économie par rapport aux relations sociales et morales comme une explication des deux guerres mondiales, comme l’a souligné Polanyi, et sa validité pour analyser ce qui s’est passé avant cette crise financière.
Dans la même ligne, nous pourrions souligner que du point de vue de l’Économie Sociale et Solidaire, le plan économique de Trump représente un autre exemple clair de «découplage» de l’économie par rapport aux relations sociales et morales. À ce stade, nous pouvons nous concentrer sur trois éléments clés qui identifient des failles structurelles potentielles dans l’approche du plan de Trump tel qu’expliqué par Varoufakis :
-
Réduction des relations économiques aux relations de pouvoir : Le plan de Trump, comme le décrit Varoufakis, est basé sur une vision purement transactionnelle où l’économie est un jeu à somme nulle. Cependant, l’ESS reconnaît que les économies durables fonctionnent comme des systèmes de coopération et d’interdépendance, pas seulement de compétition.
-
Absence du facteur de réciprocité : Le modèle bilatéral «centre-rayons» proposé par Trump manque du principe de réciprocité que l’ESS identifie comme fondamental pour la stabilité des systèmes économiques. Les relations économiques internationales stables sont construites sur des avantages mutuels reconnus, pas sur des impositions unilatérales.
-
Conception erronée de la valeur : Trump met l’accent sur la production de biens «masculins» comme l’acier, ignorant que la valeur économique émerge de multiples sources, y compris les soins, les services et les biens relationnels que l’ESS considère comme centraux non seulement pour le bien-être mais aussi pour maintenir en fonctionnement des économies compétitives. C’est également un point où les propositions de réponse européenne articulées autour du rapport Draghi se trompent.
À part ces éléments, nous trouvons une proposition du nouveau paradigme économique, une fois que le modèle néolibéral qui a soutenu la proposition de mondialisation des administrations américaines précédentes, et qui est aussi l’écriture sacrée par laquelle la proposition de l’UE est régie, semble plus qu’enterré. Ainsi, ce que certains experts appellent le néo-mercantilisme soutiendrait l’utilisation du pouvoir étatique (que ce soit militaire ou par des mesures d’agression économique comme les tarifs) pour simultanément fixer la nouvelle normativité économique. Le nouvel ordre recherché par l’administration servirait à «matérialiser» l’hégémonie américaine d’une manière différente de celle des institutions de ce pays (avec les institutions multilatérales comme le FMI ou l’OMC maintenant défunte).
Cependant, la question demeure de savoir si cette intervention risquée (menace tarifaire combinée à des négociations bilatérales pour imposer des actions spécifiques aux différentes banques centrales et autres autorités de supervision/régulation de l’UE, de l’Asie et de l’Amérique) sera suffisante pour que le comportement des marchés change par rapport à ce que prédirait jusqu’à présent le paradigme économique dominant. C’est-à-dire qu’avec cette proposition de Trump, on obtiendrait une sorte de «quadrature du cercle» économique, surmontant ainsi ce que les économistes appellent le «trilemme» ou la «trinité impossible» de la politique monétaire internationale. Ce principe établit qu’un pays ne peut pas maintenir simultanément :
-
Un taux de change contrôlé (ou faible, comme le souhaite Trump)
-
La libre circulation des capitaux (essentielle pour maintenir le dollar comme monnaie de réserve)
-
Une politique monétaire indépendante (taux d’intérêt bas, comme le veut Trump)
L’utilisation d’une action ouvertement belliqueuse (sans oublier que les administrations précédentes n’étaient pas non plus exactement des ONG caritatives) peut déclencher non seulement des comportements complaisants à moyen et court terme, mais aussi des stratégies à long terme qui répondent également à ce nouveau paradigme de l’utilisation ouverte de la force. Non seulement parce que certains acteurs peuvent être contraints de se jeter dans les bras des nouveaux blocs antagonistes (Chine-Russie), mais parce que l’identification d’intérêts communs avec un acteur ouvertement égoïste par ses alliés traditionnels se rompt et, de là, des stratégies divergentes à moyen et long terme sont générées, qu’ils le veuillent ou non, par des dirigeants plus enclins à s’aligner sur les États-Unis.
Ainsi, et revenant à une analyse ESS, la tentative de Trump de reconfigurer l’économie internationale par la coercition économique devrait rendre plus évidente la nécessité de générer ce que Polanyi appelait des «contre-mouvements protecteurs» :
-
Accélération des systèmes alternatifs : Au lieu de renforcer l’hégémonie américaine, le plan pourrait accélérer la création de systèmes monétaires alternatifs (comme le suggère Varoufakis avec les BRICS), affaiblissant la position des États-Unis à long terme.
-
Fragilisation des chaînes d’approvisionnement : L’approche transactionnelle ignore la complexité des chaînes de valeur mondiales, qui ne peuvent pas être facilement reconfigurées par des décrets unilatéraux sans générer des coûts sociaux significatifs. Cela alimentera les mouvements sociaux et politiques désireux de se séparer de la position américaine. Cela pourrait aussi être une opportunité pour démontrer la supériorité des modèles de chaînes de valeur internationales de l’ESS.
-
Désintégration de la cohésion sociale interne : La tension identifiée par Varoufakis entre satisfaire Wall Street ou la classe ouvrière reflète précisément le problème du découplage moral. Quand l’économie se déconnecte de la société, elle génère des tensions qui finissent par exploser en crises sociales, tant aux États-Unis qu’en Europe si nous ne sommes pas conscients que notre réponse doit correspondre à un modèle social et économique différent, malgré le rôle croissant de l’extrême droite tant dans les gouvernements nationaux que dans les propositions qui semblent émaner de la nouvelle UE.
Il en est ainsi parce que nous ne pouvons pas oublier que la proposition de transformation sociale et environnementale de l’ESS n’est pas un artifice «woke». Qu’un mensonge soit répété ne le rend pas vrai, bien qu’il fasse croire beaucoup de gens. La proposition de l’ESS répond à des changements et tendances réels qui ne disparaîtront pas avec un «nouvel ordre économique», mais seront plutôt renforcés.
Du point de vue de l’ESS, les alternatives que nous construisons sont plus efficaces précisément parce qu’elles reconnaissent la nécessité de cadres réglementaires spécifiques, et non de déréglementation. Le rapport sur l’accès au financement pour les entités de l’Économie Sociale et Solidaire, qui sera bientôt publié par le groupe de travail de l’ONU sur l’ESS, et auquel j’ai eu l’opportunité de collaborer, documente comment les modèles financiers démocratiques génèrent une compétitivité différentielle basée sur la minimisation des externalités négatives. Alors que le trumpisme propose de déréglementer pour être compétitif, l’ESS démontre que la réglementation adaptée et les cadres de supervision spécifiques pour les coopératives, les mutuelles et les entreprises sociales stimulent l’innovation sociale et la durabilité économique. La responsabilité environnementale et sociale n’est pas un fardeau mais un avantage concurrentiel sur des marchés de plus en plus conscients des impacts globaux. Ces expériences concrètes montrent que la compétitivité réelle et durable ne provient pas de l’élimination des règles, mais de leur adaptation intelligente aux objectifs sociaux et environnementaux partagés.
Depuis des décennies, nous construisons des systèmes économiques avec une plus grande résilience et autonomie. Notre proposition théorique démontre sa viabilité, même dans des conditions adverses, par le renforcement des marchés sociaux et des circuits économiques locaux ; le développement de systèmes financiers éthiques moins dépendants des marchés mondiaux et capables de promouvoir l’innovation technologique au service des personnes ; et la priorisation de chaînes d’approvisionnement plus courtes, plus durables et démocratiques. Le commerce équitable, les instruments de capital patient, les propositions de logement en cession d’usage et les entreprises à propriété partagée représentent des outils concrets qui devront être multipliés pour contrer la vulnérabilité aux manœuvres coercitives proposées par le modèle néo-mercantiliste.
Dans ce contexte, nous devons défendre la proposition de l’ESS non seulement comme une proposition «moralement» plus juste, mais comme une proposition qui, précisément parce qu’elle inclut la dimension morale dans son analyse, aboutit à des analyses et des recettes qui sont plus efficaces à moyen et long terme. Nous devons donc défendre une politique économique internationale alternative, basée sur ces approches hétérodoxes, qui reconnaît que :
-
La monnaie est fondamentalement un instrument social et politique, pas simplement un «bien» à valoriser ou dévaluer stratégiquement, découplé de ses effets sur la société et sur la grande majorité du tissu économique de l’UE.
-
La durabilité économique nécessite des circuits économiques circulaires et réciproques, pas des relations extractives unidirectionnelles.
-
Le développement économique authentique doit intégrer des objectifs sociaux, environnementaux et de bien-être, pas seulement des métriques de production industrielle ou d’excédent commercial. Sans ces objectifs, nous cesserons d’être compétitifs.
Le dilemme actuel n’est pas simplement entre le néolibéralisme et le néo-mercantilisme, mais entre une économie découplée de la société — que ce soit dans sa version mondialiste ou nationaliste — et une économie réintégrée dans le tissu social, écologique et moral. Le défi face à la révolution trumpiste ne consiste pas à défendre avec nostalgie l’ordre néolibéral précédent, mais à profiter de cette rupture pour avancer vers un paradigme économique véritablement différent. L’ESS n’offre pas seulement une critique bien fondée des deux modèles, mais aussi une feuille de route cohérente pour naviguer dans la turbulence à venir. Si l’Europe veut éviter d’être piégée entre la belligérance américaine et les alternatives autoritaires, elle doit d’urgence construire sa propre voie, sa nouvelle compétitivité basée sur une proposition ancrée socialement et environnementalement.
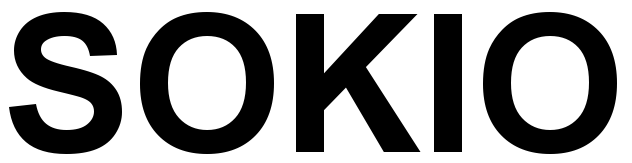

Comentarios recientes